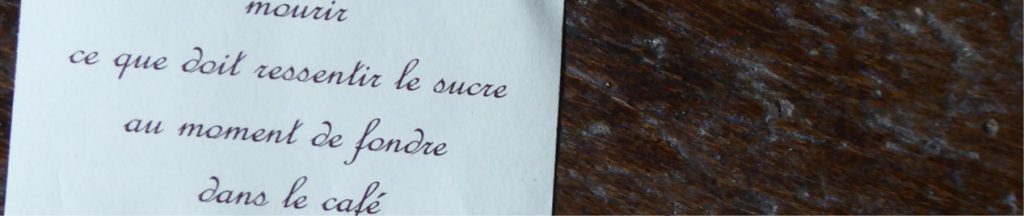
Le chien aveuglé par la lune, Tibor Zalàn, traduction du hongrois avec Jenö Farkas,
Palamart, 2017
Présentation
Quelques moments qui n’en finissent pas
Quarante ans après mes adaptations de quarante-cinq poètes hongrois contemporains (et dix poètes historiques)[1], me voilà à nouveau essayant de faire endosser l’habit de la langue française à une poésie hongroise. Ce n’est pas une plus mince affaire aujourd’hui qu’autrefois.
La première difficulté, la première folie, c’est d’offrir une version lisible, claire, honnête et de bonne foi (autant qu’il est possible) du texte de départ (ici le hongrois) sur le plateau de qui aura à en donner une version littéraire dans la langue d’arrivée (ici le français). Ce fut le travail terriblement ardu de mon ami Jenő Farkas, qui s’en est acquitté de manière aussi courageuse qu’exigeante.
Car la traduction poétique est une montagne qu’on attaque depuis ses deux versants, nord et sud, sachant toutefois qu’on n’atteint jamais tout à fait le sommet… de la perfection ! La seule espérance – mais aussi la seule exigence absolue – est d’atteindre ce fameux niveau d’insatisfaction supportable qui est mon mantra en matière d’adaptation poétique.
Slalomant à travers des « subtilités » poétiques, des rimes évidentes et d’autres cachées, des jeux sur les niveaux de langue et des références implicites, nous nous devions, à nous deux, de parvenir à une précision de diamantaires.
Traduire la poésie de Tibor Zalán c’est, en rêve, se retrouver acculé au fond d’une impasse, face à un homme ivre armé d’un coutelas : pas d’échappatoire. On va y passer. Et soudain – c’est un rêve ! – nous voilà hors de l’impasse. L’homme pose son bras sur notre épaule, et l’on s’en va boire une bière à la terrasse où nul ne nous connait. On peut, les partageant, se libérer alors de nos joyeuses cruautés, de nos hantises adolescentes, de nos névroses obsessionnelles de chérubins tardifs.
Quoi qu’il en soit on n’est pas seul : ça crie partout autour de nous. Reste plus qu’à organiser la cacophonie du monde. Ce n’est pas une faible gageure.
À l’image du monde, la poésie de Zalán est pleine d’oxymores, d’ambiguïtés, de répétitions et de répétitions et de répétitions. Des images reviennent avec la régularité d’un marteau cognant sur l’enclume des mots comme pour les tordre et leur donner la forme désirée – et des contours aléatoires. Jeux de mots, citations caviardées, métaphores aussi floues que provocantes, références absconses. Face à ce qui pourrait parfois s’apparenter à quelque charabia mystico-graveleux, il nous faut apprendre à plonger en apnée dans cette langue, afin de rencontrer une vérité de l’homme plus sensible, plus sincère – et peut-être plus pure. Un cristal enfoui sous des tas de galets.
Au bazar des mythologies, l’inspiration de Zalán, pleine de désirs baudelairiens, chine des sépias pornographiques dont il fait des images pieuses. Comme s’il tentait de reconstituer une foi perdue. Pour se sauver de quelque intime malédiction ? Chaque moment qu’il chante serait le fruit d’une roulette russe. Chaque moment un moment qui n’en finit pas. Entre sa poésie et le lecteur, on ne sait plus très bien qui apprivoise qui. Sans doute que ça fonctionne dans les deux sens. Fausse humilité, inquiétude surjouée, tout est théâtre d’ombres déformées : les scènes qui se jouent n’ont pour décor que la perplexité de notre étonnement.
Enfin (car il faut toujours conclure une préface par une citation), nous pourrions, avec Zalán, résumer nos chemins croisés de poésie par ce vers, innocemment jeté au seuil ultime d’un poème :
je ne sais plus d’où vient le chant.
Nous non plus, mais, quoi qu’il en soit, voici, dans les pages qui suivent, ce que l’on fit du sien…
Marc Delouze, juillet 2017
[1] réunis dans Poésie hongroise, Anthologie, Corvina Kiadó, Budapest/Editeurs français réunis, Paris, 1978
Extrait
Étrange réveil / Idegen ébredés
Las d’atteindre
le matin
tout au bout
des nuits blanches Les aubes
me laminent
me rongent
me soulèvent dans l’air raréfié
puis me ramènent à terre
transis évanoui
Plus la force
d’ignorer
qu’il n’est de lieu
où parvenir
je n’ai plus guère
le pouvoir d’ignorer
les clameurs des galeries
autrefois écroulées
Même mes proches
méconnaissent ma solitude
loin de tout
loin des êtres
ce qu’il m’en coûte
Depuis longtemps
je cohabite avec moi-même
en étranger
même si nul ne me blesse
ni ne me frappe
En moi loge
une monstrueuse charogne
qu’il me faut porter Pas facile
Mais je sais
que je dois rester étranger
à mes nerfs À ma condition
aux heures paisibles
je repousse avec indifférence
surgis de la pénombre des ossements
porteurs d’une infinité d’histoires
passées pour la plupart
s’agglutinant
en un éclair
Le pendule de la Lune
déchire le cœur battant du ciel
D’où qu’elles viennent
je n’attends ni miséricorde
ni rédemption
Depuis la maison jaune
une ombre me fait signe
Une aube nouvelle point
Je me prépare
À nouveau l’odeur du noir
À nouveau se déploie
le vaste tourbillon
des lourds nuages
