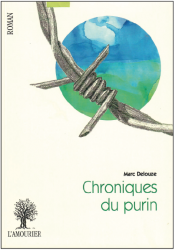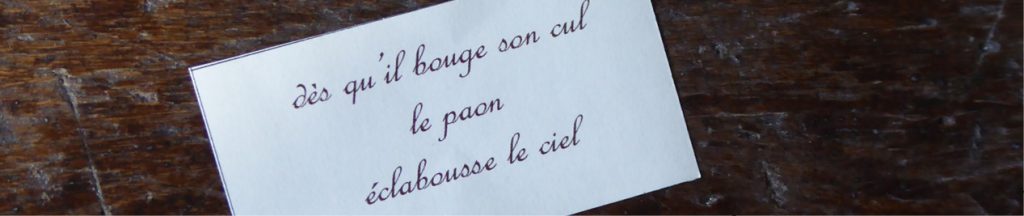
Chroniques du purin,
roman, l’Amourier, 2016
Format : 14,5 x 20 centimètres
Pages : 168
Dessin de couverture : Martin Miguel
Collection : “ Fonds Prose ”
Extrait
Le jour le soleil banni tourne autour de la terre comme une mère en deuil tenant une lampe.
Cormac McCarthy
Quand je ne suis pas à Paris j’arpente les chemins de Puisaye et Foreterre découverts depuis peu. Citadin pas dégourdi de la campagne il m’arrive souvent de trébucher
(la peur dans ces moments de tomber dans un trou du temps
une pelletée de terre jetée dans une fosse).
Mais le plus souvent je me réfugie dans ma nouvelle maison entouré de livres et de notes.
Depuis des mois, où que je sois quoi que je fasse ma tête rumine des pensées tirées telles quelles d’un sac à linge sale. Une âcre odeur de fatigue s’en exhale.
De jour en jour de nuit en nuit je m’interroge.
Je vis.
Je mange.
Je me livre à l’inoffensive tyrannie des obligations quotidiennes avec l’application méticuleuse d’un artisan penché sur son ouvrage.
Je ne cours pas les cimetières ni les morgues.
Je ne consulte pas la liste des décès dans les Carnets du Monde et néanmoins ce sont des morts qui m’interrogent.
Je vis au milieu de tous ces morts. Ils m’accompagnent. Ils ne me quittent pas d’une semelle. Ils se pressent dans mon ombre quelle que soit l’heure
(que je marche ou lise ou mange ou dorme).
Ils s’installent autour de ma table.
Ils s’assoient sur mon lit.
Ils flottent dans le noir quand je ferme les yeux.
Ils me parlent entre les lignes des livres que je lis.
Comment faire au bout du compte la part des choses
(la part impossible des choses).
Voyageant constamment entre ville et campagne, entre déracinés et enracinés
(moi qui ne possède pas de racines – leur immobilité me terrifie)
je me trouve à la croisée des chemins qui viennent de partout et ne vont nulle part. Entre les morts qui me parlent et les vivants à qui je fais semblant de parler, entre Babel et balbutiements il me faut défricher le chemin étroit d’une parole qui me mènerait là où ma vie n’a pas vécu
(ma vie d’avant la vie – qui prend sens à tant de sources ignorées).
Reclus dans ma campagne
(où j’ai tout le temps d’écrire sans être contraint d’écrire tout le temps)
je tente jusqu’à pas d’heure de combler avec le sable des mots le lit à sec de ma mémoire.
***
Des souffles de morts moi vivant j’inspire, foule une poussière de morts, dévore les abats pisseux de tous les morts.
James Joyce
(Ça commencerait comme une autobiographie.)
Il fait beau à Paris ce 15 avril 1945. Ce jour-là, quelque part loin vers l’Est, Robert Anthelme s’accroche à la vie comme un noyé aux algues qui l’emportent.
« la lucarne s’est éclaircie, la caisse a blanchi progressivement et ce qui grouillait par terre est sorti de la nuit, le jour s’est aussi levé sur nous, on avait encore des yeux pour le voir, il y avait même des nuages que l’on voyait circuler à travers la lucarne, les poux se sont endormis avec le jour, ils étaient tous là sous la chemise, dans les poils du sexe, partout, pleins, on les sentait, on avait l’intuition de leur poids, mais ils ne remuaient plus, le train s’était arrêté plusieurs fois dans la nuit et quand le wagon était immobile on avait davantage senti leur présence, la prison était devenue encore plus étroite, plus précise, quand elle ne se perdait plus dans la vibration du wagon leur circulation devenait d’une netteté intolérable, maintenant, avec le jour, on sentait moins la brûlure mais seulement la crasse de la chemise collée, l’épaisseur d’un grouillement endormi »
Ce même jour, Evelien van Leeuwen, emportée quasi mourante depuis la petite gare de Bergen-Belsen vers une destination inconnue, n’a d’yeux que pour la beauté du monde aperçu ce jour-là depuis le train qui n’en finit pas de s’arrêter en rase campagne.
« un printemps splendide, la nature est d’une beauté envoûtante, on a l’impression que ce lieu dégage une force qui guérit, qu’une part de toute cette végétation bourgeonnante transmet sa vitalité à cette troupe d’êtres affamés et harassés, dans le ciel planent déjà les prémices de la paix et de la liberté, les gens paraissent plus gentils et plus humains les uns pour les autres »
Ce même jour, vers quatre heures de l’après-midi, les premiers cris du nouveau-né ne parviennent pas à couvrir ceux de la mère dont le corps se déchire
(restée sans voix et sans regard sa vie durant pour ce brutal destin émané d’elle).
Les premiers mois rien que des ombres dans les yeux, sur la langue l’âpre goût du lait qui l’empoisonne, le tympan purulent qu’on se refuse de crever.
Plusieurs nuits à attendre, dans le taudis, que la toute nouvelle pénicilline
(merci Docteur Lederer)
fasse son œuvre et sauve l’ouïe de l’enfant qui ne cesse de geindre.
Ce même matin, Shigematsu
(ou était-ce Tôge Sankichi ?)
sur le point de sortir pour aller prendre son train à la gare de Yokogawa
(Hiroshima)
note dans son journal
« 6 août, beau temps ».
puis se rend à son travail. Il se tient debout sur le marchepied du wagon.
« à trois mètres du train qui allait partir j’ai vu une boule de lumière si forte qu’elle m’a aveuglé tout est aussitôt devenu noir je n’ai plus rien vu, j’ai rouvert les yeux, tout ce que je voyais paraissait estompé dans une brume brun clair, j’ai aperçu un énorme cumulus qui s’élevait très haut dans le ciel sur une seule jambe énorme se déployant horizontalement à son faîte et grandissant à vue d’œil comme un champignon en train de s’épanouir, le nuage semblait immobile mais ne l’était point il élargissait sa tête branlante tantôt à l’est tantôt à l’ouest et chaque fois qu’il s’agrandissait une part quelconque de son gros corps de champignon jetait un éclair et changeait de couleur devenant rouge violette azur verte, je me sentais réduire »