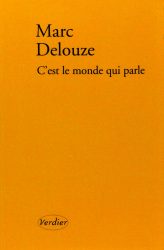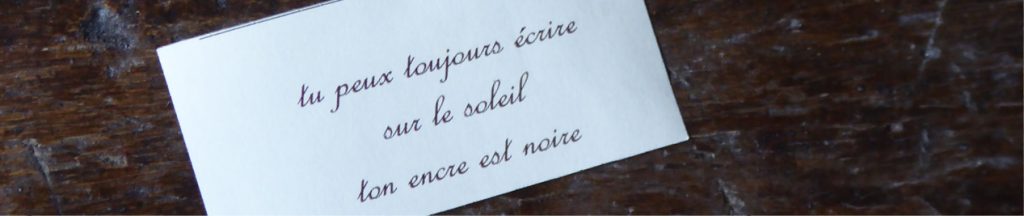
C’est le monde qui parle,
récit, Verdier, 2007
Extrait
(…)
à dix heures du soir il fait plus de trente degrés, toutes vitres ouvertes la Peugeot fonce à cent vingt à l’heure sur un pont interminable qui relie deux lagons
il arrive que des bandits attaquent en pleine ville et tirent sur les conducteurs pour leur voler leur auto, leur argent, leurs papiers, tout ce qu’ils trouvent, foncer dans la nuit est la plus sûre des protections
à la sortie du pont le véhicule est arrêté par un groupe de militaires dépenaillés agglutinés autour d’un brasero dont les pieds s’enfoncent dans un magma de sable, de déchets, de bitume fondu, un soldat aux yeux rouges s’avance pieds nus vers l’auto, tapote négligemment sur le toit avec le canon de son fusil
– mus’ give money !
quelques billets froissés ainsi qu’un paquet de cigarettes passent par la vitre baissée et disparaissent dans la poche d’un treillis, deux, trois fois la même scène se reproduit avant d’atteindre le quartier d’Ikéja, l’auto s’arrête devant un portail de fer, nous sommes quatre à descendre et nous soumettre à un contrôle serré destiné à vérifier qu’aucune arme ne pénètre dans la « République » de Féla Anikulapo Kuti
Lagos
on ne vient pas par hasard dans cette vaste cour entourée de murs de parpaings, où la junte militaire n’ose pas encore intervenir mais qu’elle surveille de près, on connaît, on est du clan, ou amené par un ami du clan, dans cet îlot de semi-liberté, vingt-quatre heures sur vingt-quatre la bière coule à flots, la parole circule librement de bouche en bouche à l’unisson de grands cônes d’où s’élève une fumée bleu pâle qui flotte dans l’air gorgé d’humidité, sur une scène de fortune une demi douzaine de musiciens aux déhanchements obscènes, aux lèvres épaisses, aux joues distendues collées à leurs saxophones, accompagnent l’ascension des fumées dans la nuit, des désirs s’insinuent sous ma peau moite, courent le long de mes nerfs, me submergent tant et si bien que je tire sans ménagement sur un des cônes brûlants qui, passant de main en main, s’est retrouvé entre les miennes, sans me douter que j’enfourche le Cheval Fou de l’héroïne, et quand Féla apparaît au-delà de minuit, mes oreilles s’ouvrent comme des fleurs carnivores, je vois l’estrade s’envoler dans la nuit, m’emportant, m’emportant, comme si le ciel soudain blême m’étouffait avec les nuages de ses poings
je me souviens d’avoir vomi mes tripes sur un parterre de fleurs luxuriantes, les narines incendiées par des odeurs de gasoil de béton moisi de poubelles grouillantes de vermine, la gorge abrasée par la poussière je me revois dans un brouillard plantant un regard torve dans les énormes bacs à palmiers qui ornent le grand hall du vaste bâtiment en forme de casquette d’officier soviétique où se déroule la cérémonie de clôture du symposium qui réunit pour la première fois en Afrique des écrivains africains francophones et anglophones, dans l’immense salle où bourdonne un essaim de gens normaux dont l’agitation me glace d’effroi j’aperçois des cadavres flottant dans un ciel de plâtre fissuré, mon corps m’échappe et part à la dérive avec la lenteur morose d’un noyé s’en allant arpenter les territoires glauques de ses propres déjections, des bruits de salle de bain creusent des ornières dans mes oreilles, des jets de vapeur forent mes yeux, des autos étrangement muettes traversent la chambre, je ne sais pas par quel sortilège je suis arrivé là, mon corps est ballotté par une houle blanche qui se referme sur moi tandis qu’un souffle léger dépose des pétales de parfum sur ma joue, des ongles rouges comme des yeux clignotants passent dans mes cheveux, ils doivent appartenir à cette femme entrevue par intermittences, une femme très douce, très patiente, très noire, très odorante
très chaude et très profonde
qui me lave de mes vomissures et de mes morves et de mes larmes, qui me porte, m’allonge, me relève, m’assoit, me parle, tente vainement de me nourrir, me rassure et plaisante et soutient mon corps noué au poteau d’un vertige intérieur, une femme anonyme et maternelle, étrangère et familière, accueillante et belle
si belle que mon estomac martyrisé en frémit lorsque j’émerge, mais elle a disparu, me laissant dans le désarroi d’encore exister, allongé au bord de la piscine déserte de l’hôtel, mon regard suit au-dessus de moi le gracieux ballet des palmiers bercés par le vent tiède qui souffle depuis l’océan tout proche, les grands bras verts agitent le crépon froissé de leurs palmes en direction de la lagune, saluant de loin les Séraphins et les Chérubins en robes blanches et bleues qui, par familles entières, attendent chaque jour le retour de Dieu
qui viendra par les flots
moi, loin de tout
loin de toi
perdu, je me relève et j’avance à tâtons dans ma nuit en murmurant
je t’aime
et la terre n’explose pas
(…)